Interview de Lilian Bathelot
 Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?
Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?
Marlaguette et le loup, de Marie Colmont et Gerda Muller m’a beaucoup ému quand j’étais enfant. Beaucoup et souvent.
À cette époque, il y avait peu de livres dans ma vie. Celui-là a dû toucher au point sensible. Je l’ai racheté quand ma fille est née et je l’ai redécouvert avec la même émotion, intacte. Je me demande si, finalement, tout ce que j’écris ne serait pas puisé dans l’émotion que j’ai découverte dans cet album magistral.
Le premier roman que j’ai lu, c’est à coup sûr L’homme à la carabine, de Claude Veillot (scénariste par ailleurs du Vieux fusil) paru dans la Bibliothèque verte. C’était le seul livre sans image dans cette maison (avec Fils du Peuple de Maurice Thorez). J’ai dû le lire vingt fois (pas Fils du peuple), quand je ne courrais pas les bois, les rues ou les filles. C’est à dire quand j’étais consigné à la maison, malade ou puni, je suppose.
Dans quelles circonstances avez-vous écrit votre première nouvelle, votre premier roman ?
Ma première nouvelle, je l’ai commise quand j’avais 17 ans, pour le prix Goncourt de la nouvelle dont j’avais appris l’existence par une réclame dans le Midi-Libre, qui en était partenaire cette année-là.
J’ai été primé.
Depuis mon Bassin minier de Decazeville, au fond de l’Aveyron, j’ai dû aller à la ville, jusqu’à Montpellier, au volant l’Austin Cooper de ma petite amie qui détestait conduire. Le permis était un détail insignifiant dans l’imaginaire qui gouvernait nos vies.
Arrivés trop tôt dans les salons d’honneur du Midi-Libre, rue d’Alger, nous étions les premiers. Mais les hôtesses étaient déjà à leur poste, avec leurs mini-jupes et leurs plateaux garnis de petits fours, de champagne et de whisky… Le lieu était très impressionnant pour un jeune plouc, colonnes, marbre au sol, lourdes tapisseries brodées aux murs.
J’ai avalé quelques verres de whisky pour me détendre.
Puis la cérémonie a commencé, les auteurs étaient appelés tour à tour au podium pour recevoir leur prix, en commençant par le dixième. J’étais troisième, il me semble, et j’ai dû continuer à picoler, j’imagine.
Le fait est que, lorsque Jean Joubert, président du jury (déjà !) m’a appelé pour me remettre mon prix, j’étais tellement bourré que je n’ai pas pu me lever du fauteuil de bridge en velours rouge sur lequel je m’étais échoué, au fond de la salle.
Sans dèc.
Il y a eu un flottement.
Finalement, coupant cours à l’embarras, Jean Joubert s’est décidé. Il s’est dirigé vers moi, entraînant le jury et son aréopage à sa suite. Ils se sont déplacés jusqu’à moi pour me remettre mon prix. J’ai tout juste pu grommeler trois mots de remerciements, paraît-il, mais je n’en garde pas souvenir.
A la fin de la cérémonie, Roland Pécout, qui avait reçu le premier prix, nous a pris en charge, ma petite amie et moi. Ils nous a amenés manger, dans un boui-boui de la rue Terral, Le Faisant doré. Puis, nous interdisant de rentrer en Aveyron en voiture, il nous a cherché une chambre. La seule disponible à cette heure tardive se trouvait dans un hôtel de passe miteux du quartier Bousseyrolles. C’était crasseux, et nous avons attrapé des morpions dont nous avons mis des semaines à nous défaire.
C’était ma première expérience de la vie littéraire.
Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ?
Non, évidemment.
Victor Hugo, à qui un gazettier de l’époque demandait comment un maître de sa stature pouvait lire aussi peu, avait simplement répondu : « c’est que les vaches ne boivent pas de lait ».
Imparable, non ?
La littérature que j’aime se nourrit de la vie. Elle transforme la vie en littérature, elle la concentre. Et la littérature qui se nourrit de littérature, c’est du pipi de chat. Non ?
Être né dans un bassin minier prédestine-t-il à être auteur de romans noirs ?
Huhu… Très drôle.
En vérité, je n’ai jamais cherché à écrire des romans noirs… J’écris des romans, depuis le début. Ils viennent comme ils viennent, je ne gouverne pas grand chose en réalité. Je fais le job, évidemment ; j’écris. Ce sont mes mains qui tapent sur le clavier, ma cervelle qui turbine, et je revendique ce que j’écris comme m’appartenant.
Pourtant, je sais bien que mes romans se bâtissent dans une partie de moi sur laquelle ma volonté consciente a bien peu de prise. Les romans qui sont écrits autrement, à partir d’une volonté, d’un plan ou de consignes, je les renifle vite et, en général, ils ne m’intéressent guère.
D’ailleurs, ce que j’écris moi-même de cette manière – avec un plan, un squelette, que l’écriture doit habiller – ne me plait pas du tout, non plus.
Aussi, je n’essaye même plus d’écrire comme cela.
Si un éditeur me demande un synopsis, je m’exécute lorsque je n’ai le choix – c’est souvent une exigences du service gestion, parait-il… Mais je préviens que je ne respecterai pas le scénario consigné. Dans le synopsis exigé pour L’Étoile noire, par exemple, l’histoire débutait pendant l’été 1936, à Barcelone, pour se terminer en juin 1944, à la libération de Paris, et le roman devait compter 300 000 signes. A l’arrivée, si le roman débute bien à l’époque prévue, il se termine en décembre 1936. Et compte 450 000 signes…
J’ai vraiment besoin que l’écriture gouverne. Qu’elle soit libre d’aller puiser ce qu’elle veut dans le fouillis qui constitue la mémoire, le vécu, le ressenti. Des trucs insaisissables, que la volonté n’aurait jamais pensé à aller pêcher là-bas dedans.
Bon, pour avoir enseigné la philo, je sais bien que tout ça n’est pas si simple. Les présocratiques avaient déjà bien pigé que la raison et les sensations sont attachées ensemble, qu’elles interfèrent sans cesse par la force des choses. Mais, je ne fais pas une thèse, là. Je force à peine le trait pour faire simple. Mais juste.
Je suis atterré quand je constate que le noir devient un fond de commerce qu’on s’échine à remplir avec des idées, des scénarios fabriqués, calculés. C’est assez exactement à l’opposé de la littérature. Mais tout le monde ou presque s’en balance, et je ne compte pas employer mon énergie à m’en désoler.
Le fait est que d’autres que moi ont casé mes romans dans les rayons du noir. Soit. D’accord. Si je ne le revendique pas plus que ça, je ne le renie pas non plus. Mais ça me concerne peu. Je ne brandis pas le noir comme un étendard. Malgré des affinités que je ne peux pas nier avec un autre drapeau, noir lui aussi. (sourire)
Vous changez en permanence de genre, d’un roman à l’autre. Avez-vous peur qu’on vous colle une étiquette ?
Bah, j’en ai des étiquettes, sur mon dos. Je m’en moque. Je ne les vois pas…
Non, j’ai juste besoin de changement. Creuser le même sillon à chaque roman, ça ne me ressemble pas. Les changements de genre, d’univers, je ne les veux pas. Je les subis. Ils s’imposent à moi. Et je les laisse s’imposer. Je suis sûr que la création, c’est savoir se laisser porter par un souffle qui dépasse l’entendement.
Votre dernier livre, Terminus mon ange, c’est un roman ou une nouvelle ? Pouvez-vous nous en parler ?
Aïe. Allez, on va pas se fâcher pour cette question, hein ?
C’est un roman.
Et oui, je peux en parler : je l’aime.
Voilà.
Plaisanterie mise à part, disons que je reconnais à tout lecteur le droit de juger de la qualité de mon écriture. En contrepartie, je m’arroge, moi, le droit de juger de la qualité de la lecture de mes lecteurs.
Et ceux qui, ayant lu Terminus, y verraient une nouvelle devaient sérieusement songer à apprendre à lire au lieu de compter les pages. (sourire bis)
La littérature peut-elle faire évoluer les mentalités ?
Je n’en sais fichtrement rien. Faudrait d’abord s’entendre sur ce que signifie « la littérature », et on ne serait pas sorti de l’auberge. Mais si on parle des best-sellers tous genres confondus, sauf exceptions lumineuses parfois, il me semble que cette littérature fait évoluer les consciences, effectivement. Vers le côté porcin – ascendant hormones, élevage intensif et rejet de lisier. (sourire ter)
Que se racontent deux auteurs qui se rencontrent ?
Ouch.
Lorsque la discussion est sincère, je ne peux pas le dire. Car je n’aimerais pas me mettre à dos les trois quarts du monde du livre. (sourire –encore)
Nan, sans rire maintenant, depuis de nombreuses années, je m’efforce de ne plus fréquenter que la fraction respectable de la galaxie bouquins (éditeurs, libraires, manifestations, satellites, etc.), et j’ai, en conséquence, surtout du bien à en dire.
Et, comme c’est du bien, je peux tout à fait le raconter à tout le monde, pas seulement le chuchoter dans le creux de l’oreille à mes ami-e-s auteurs de peur d’être éjecté du circuit.
Nan… Moi, j’ai de la chance… Je suis déjà éjecté du circuit des fâcheux qui considèrent que l’auteur a déjà bien de la chance lorsqu’on s’intéresse à lui ; et qu’il faut qu’il soit bien ingrat et présomptueux pour espérer, en plus, un peu de respect pour son travail, son temps, son porte-monnaie et sa personne.
Parce que le fait est que, le plus souvent, l’auteur est maltraité par le monde du livre.
Mais le plus désespérant, c’est le nombre d’auteurs qui acceptent la bouche en cœur ces mauvais traitements dans l’espoir d’être édités, puis invités ici ou là, d’exister médiatiquement. C’est pathétique. Mais humain. Désespérément humain.
Avez-vous déjà en tête le thème de votre prochain roman ? Si oui, pouvez-vous nous en parler ?
J’ai plusieurs fers au feu, plusieurs textes en cours, d’autres encore en envie. Ce qui signifie que rien ne s’est encore imposé vraiment comme Le prochain.
Mais je sens que la plume me démange en ce moment.
Je vais plonger tout bientôt, mais j’ignore encore de quel rocher précisément.
Les derniers mois, j’ai été bousculé par des contingences matérielles. Des bêtises comme savoir où poser mon campement ailleurs que sous un pont, nourrir mon frigidaire et mon automobile.
Je ne sais pas pourquoi, ces bêtises contrarient facilement les velléités littéraires. (sourire quater) Mais, je préfère ne pas en dire davantage. J’ai bien compris qu’un auteur qui parle de contingences matérielles, c’est un peu indécent.
Pur esprit, je dois être.
Amen.
Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
Je viens juste de terminer Le bref été de l’anarchie, de Hans Magnus Enzensberger.
Une lecture au long cours, étalée sur presque une année. Un livre auquel j’ai rendu visite presque tous les jours, au fil des saisons. Je l’ai savouré page à page, paragraphe par paragraphe, parfois. Dégusté à petites lapées.
C’est mon père qui me l’avait offert, ce livre, peu avant de mourir.
J’ai attendu longtemps avant de pouvoir commencer à le lire. Il fallait qu’il me fasse un signe. Il est resté sur mon bureau plusieurs années durant. Je le voyais quotidiennement, le regardais parfois. Il était là, dans ma vie. Je le manipulais de loin en loin, mais il me disait chaque fois que ce n’était pas encore le moment.
Et puis un jour, il a bien voulu se laisser faire.
J’ai commencé à le lire. Lentement. Avec sensualité. Comme on devrait toujours lire la philosophie. Il m’a accompagné presque une année entière, donc. Me parlant tranquillement de Buenaventura Durruti, d’amour, de révolution, de Catalogne, d’Aragón et d’utopies concrètes, avec des inflexions dans lesquelles je ne pouvais m’empêcher de retrouver un peu du souvenir de mon père.
J’ai beaucoup aimé ce compagnonnage. Bien loin de la littérature de divertissement et de ses insignifiances.
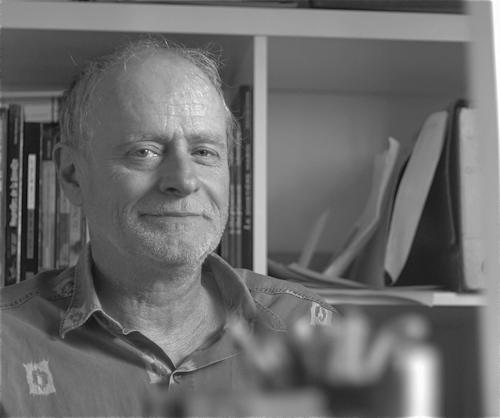
Lilian Bathelot
Lilian Bathelot naît en 1959, dans le bassin minier et industriel de Decazeville, dans le sud de la France. Un temps saltimbanque et cracheur de feu, un autre professeur de philosophie puis conseil en communication, les contre-pieds de son parcours – qui sont aussi passés par l’usine et le bâtiment – débouchent en 1997 sur l’écriture….
Ses trois premiers romans paraissent en 1998 et 1999, aux éditions Climats.
Après plusieurs autres romans parus aux éditions Albin Michel et Métailié notamment, C’est l’Inuit qui gardera le souvenir du Blanc, son dixième titre, est plébiscité par la critique et les libraires. Il est sélectionné pour une vingtaine de prix littéraires.
En mai 2010, L’Étoile noire, paraît aux éditions Gulf Stream, très vite coup de coeur de nombreux libraires, et accueilli par des critiques enthousiastes. « Meilleures ventes » FNAC en ligne.
2012 voit la sortie de Kabylie twist, encore aux éditions Gulf Stream, avec une nouvelle kyrielle d’échos positifs des professionnels du livre et des lecteurs.
Côté littérature, depuis 2009, plusieurs titres sont disponibles au format numérique, chez publie.net.
Parallèlement, Lilian Bathelot a aussi écrit pour le théâtre et la radio.
En 2013, il signe sont premier film, co-réalisé avec Renée Garaud, La fabuleuse histoire de la Paravision.





