Interview de Colin Niel
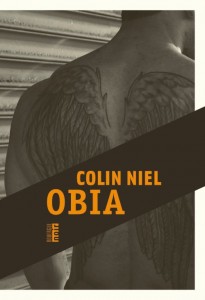 Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?
Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?
Le premier, c’est vraiment la question ? Alors je n’ai plus le titre exact en tête mais ça devait être un Fantômette en bibliothèque rose, vers 7-8 ans. Je me souviens d’une scène d’anthologie. Ça se passait dans une grotte sombre, Fantômette était toute seule et devait absolument allumer une bombe pour sauver je ne sais plus qui. Mais les méchants avaient changé le modèle d’explosif pour que la mèche se consume plus vite et que notre héroïne n’ait pas le temps de fuir après l’allumage. On avait peur pour elle, le suspense était insoutenable. Mais Fantômette, c’est pas n’importe qui, elle est un peu dure à cuire vous voyez, hard-boiled comme on dit. Alors elle avait pigé le piège et déchiré un bout de son costume pour faire une mèche plus longue qu’elle avait noué à la bombe. Futé, non ? J’étais déjà en plein dans les codes du polar. Fantômette, c’était du thriller !
Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ?
Un lecteur, oui, ça me parait indispensable. Pour moi écrire, c’est d’abord lire, tout commence par là, par l’expérience de la lecture. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse écrire un bon bouquin sans avoir soi-même connu l’émotion, le choc qu’on peut ressentir en refermant un grand livre. Ensuite on peut discuter ce que qu’est un « grand » lecteur. Pour ma part je lis beaucoup dans le sens souvent, mais je lis lentement parce que j’ai une capacité de concentration limitée. Du coup je ne sais pas si je fais partie des grands lecteurs, et j’ai toujours eu un petit complexe de ce côté-là, l’impression malgré tout de continuer de faire partie du monde des « scientifiques » plus que de celui des « littéraires », reproduisant sans le vouloir cette frontière idiote héritée du lycée.
Quels chemins vous ont amenés à l’écriture ?
Je pense que, comme beaucoup de monde en fait, j’ai toujours eu l’envie d’écrire, beaucoup plus jeune déjà j’avais entamé un polar jamais terminé. C’était moins une attirance pour la langue française, pour les mots, que pour la création d’histoires, de personnages, la construction. J’avais un boulot où on écrivait beaucoup, des notes techniques, des rapports, j’étais à l’aise avec mon clavier, mais longtemps je me suis persuadé que le passage à une écriture « littéraire » représentait un fossé trop large, que ce monde n’était pas le mien et que d’autres avaient bien plus de choses à dire que moi. J’ai donc mis du temps à me lancer. Et finalement c’est la Guyane qui m’a débloqué. C’est en revenant de mes 6 années passées là-bas que je me suis dit que j’avais peut-être ramené avec moi une « matière » qui pouvait intéresser quelques lecteurs. Alors je me suis lancé dans l’écriture des Hamacs de Carton.
Vous avez été comédien, magicien, ingénieur. Laquelle de ces trois vies vous aide le plus dans l’écriture de vos romans ?
Bon, comédien, magicien, j’ai toujours été amateur même si fut un temps je donnais quelques cours de magie et j’écumais les concours. Ce petit univers de la scène que j’ai toujours aimé côtoyer à petite échelle a été important pour moi, c’était mon pied dans un autre milieu que le mien. Mais en fin de compte, je crois que c’est mon métier d’ingénieur qui m’a le plus appris. Pas par le côté technique du boulot, mais sur le plan humain. Parce qu’en m’occupant de la création d’un parc national en Guyane, en encadrant des équipes d’agents de terrain, en arpentant les couloirs des ministères, j’ai été plongé dans le monde et dans toute la complexité des rapports entre les hommes et des femmes. Et je pense que c’est là que j’ai pu voir (et peut-être un peu compris) quelques-uns des ressorts de la société.
Les voyages forment-ils les auteurs ?
Les auteurs, je ne sais pas, mais pour moi, oui, c’est important. Je suis convaincu qu’une grande partie des conflits humains viennent des écarts culturels et qu’on a toujours tendance à les sous-estimer, qu’ils soient évidents comme entre un australien et un inuit, ou plus subtils mais pas moins sensibles comme entre deux voisins que la vie a juste façonné différemment malgré la proximité. Et voyager, c’est un moyen de mesurer cela, de prendre conscience de l’ampleur des fossés et de ce que ça coûte d’essayer de les combler.
Quel est le rôle du roman policier ?
Avant tout, c’est la base de tout livre, faire passer un bon moment. La force du polar à mon sens, c’est de pouvoir aborder des sujets très sérieux sans se prendre trop au sérieux, sans ennuyer le lecteur.
La vie d’auteur est une drôle de vie. Avez-vous une anecdote amusante à nous raconter ?
Pour moi c’est surtout en Guyane que je me sens un peu romancier, à supposer qu’on le soit un jour tant chaque nouveau projet est un recommencement. Mais lorsque je me rends en Guyane pour mes recherches, je fais toujours de drôles de rencontres. Pour mon dernier bouquin je voulais interviewer la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni. Je les ai appelés, mais comme ils sont très à cheval sur la hiérarchie, ils m’ont renvoyé sur le commandant de gendarmerie, le général qui dirige tout le monde sur la Guyane, j’ai du passer par sa secrétaire. J’ai finalement eu un RV un matin à 8h, j’ai débarqué dans mes petites souliers avec une belle chemise et tout. Et finalement dès que j’ai passé la porte, le général avec tous ses galons m’a dit « vous pouvez dédicacer votre premier livre pour ma femme ? ». D’un coup ça s’est bien détendu et la discussion a été très amicale.
Comment prennent vie vous personnages ?
Au fil de l’écriture, toujours. L’intrigue, l’histoire, le cadre, les décors, tout cela est conçu dans ma tête avant de commencer à écrire, mais les personnages, non. Eux, je n’arrive pas à les cerner avant la fin du livre, et c’est seulement lors de la réécriture qu’ils se stabilisent.
Pouvez-vous nous parlez de votre dernier roman, Obia ?
Obia, c’est mon dernier bébé. Obia, c’est la course folle de la jeunesse guyanaise pour se trouver une place dans une population qui explose avec un marché du travail légal déjà saturé. C’est les trafiquants de cocaïne qui trouvent chez ces jeunes un vivier de mules inépuisable pour envoyer leurs ovules de drogues vers l’Europe, à tel point que faire la mule est devenu d’une banalité désarmante à Saint-Laurent du Maroni. C’est une jeunesse marquée, parfois sans le savoir, par la guerre civile du Suriname qui dans les années 80 jeta 10 000 réfugiés vers la Guyane, et qui en subit encore les conséquences. C’est la cohabitation entre anciens et nouveaux guyanais, avec toutes les rancœurs, toutes les jalousies, toutes les haines qu’on essaie d’enfouir mais qui reviennent sans cesse. C’est les politiques occupés à gratter des voix plus qu’à panser les plaies du passé. C’est un peu de tout ça, sur 500 pages.
Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
Lu, je ne vous le dirais pas. Aimé par contre, je dirais Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal. Et en polar, ma plus belle lecture cette année : Aux Animaux la Guerre, de Nicolas Mathieu.
Photo : (c) Hacquart et Loison/Opale/Leemage

Colin Niel
Colin Niel est né en 1976 à Clamart. Il grandit au 12ème étage d’une ZAC à Issy-les-Moulineaux. Il s’intéresse aux ailleurs, voyage autant que possible, observe les oiseaux. Magicien, comédien amateur, il s’essaye à tout, avec plus ou moins de succès. Il suit des études en agronomie, en environnement, en écologie, et finit ingénieur, spécialisé dans la préservation de la biodiversité.
Il quitte alors la métropole pour travailler en Guyane durant six années qui lui permettent de côtoyer les nombreuses cultures de la région et particulièrement les populations noires-marrons du fleuve Maroni. Il y est notamment en charge de la création du parc national amazonien, une mission qui le marque beaucoup. Plus tard, il est directeur adjoint du parc national de la Guadeloupe.
Amateur de romans noirs denses et humains, influencé par des Indridason, Lehane ou Hillerman, il se lance dans le polar à son retour de Guyane. Ainsi nait Les Hamacs de Carton, roman policier profondément social et très documenté, inspiré par une réalité trop quotidienne dans ce territoire aux frontières perméables : celle des immigrés, apatrides et autres étrangers en situation irrégulière. Un premier roman remarqué qui inaugure une série d’enquêtes menées par le capitaine Anato en Amazonie française.






Merci à Paroles d’auteur pour ce bel entretien
avec Colin Niel,
dont j’ai adoré le roman,
plongée passionnante dans une région française
attirante et mystérieuse pour beaucoup.
Colin Niel est un auteur de grand talent,
plein d’empathie pour ses personnages,
et qui connaît la situation à fond.
Pour ceux qui aiment les bons polars bien documentés.